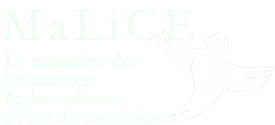Résumé
Cet article part de la constatation que dans les moments forts de De la littérature, Madame de Staël rompt avec le style monotone de l’exposé magistral pour adopter un style fiévreux et haletant caractérisé par un fréquent recours aux asyndètes entre mots et membres de phrases, aux parataxes entre propositions, aux anaphores et aux épanorthoses, faisant souvent intervenir des anaphores. Tout en décrivant des manifestations de ce style que j’ai appelé le « beau négligé » et qui représente une troisième voie entre l’héritage de la rhétorique cicéronienne et le style lapidaire des Révolutionnaires français, je suggère de voir dans cette esthétique l’adaptation au français de l’écriture macphersonienne et du Sturm und Drang allemand. Une analyse d’un sommet du genre extrait des Souffrances du jeune Werther dans la traduction française qu’a sans doute connue Madame de Staël montre tout ce que la femme de lettres doit au précédent goethéen. C’est cette esthétique de l’indécision et de l’hésitation que semble décrire « Art poétique » de Verlaine.
Abstract
The starting point of the present study is a constatation on the style of Madame de Staël’s De la littérature. It appears that in the highlights of De la littérature the author departs from the humming style of the magistral essay and resorts to a feverish and panting writing characterized by frequent asyndeta between words and cola, by parataxes between clauses, by anaphoras and by epanorthoses with or without anaphoras. In addition to a description of the manifestations of this style that I called beau négligé “beautiful casualness” and represents a third way between the legacy of Ciceronian rhetoric and the laconic style of the French revolutionaries, I suggest recognizing in this aesthetic the adaptation to French of Macphersonian writing and German Sturm und Drang. A stylistic analysis of an emblematic place in Goethe’s Werther in the French translation that was probably known to Madame de Staël shows how much this author owes to Goethe’s model. It seems that Verlaine’s “Poetic Art” is describing this kind of aesthetic of indecision and hesitation.
Dans De la littérature on voit se manifester le goût de Madame de Staël pour des figures telles que l’asyndète, la parataxe asyndétique,1 l’épanorthose et l’anaphore. Les trois premières de ces figures ont en commun l’absence de termes coordonnants tandis que l’anaphore peut éventuellement recourir à une conjonction. La renonciation à la coordination permet notamment de créer un effet réel ou simulé d’indécision ou d’hésitation, notamment dans le cas de l’épanorthose que les Latins appelaient tantôt correctio, traduction littérale du grec ἐπανόρθωσις, tantôt disjunctio.
Nous verrons à l’aide d’exemples que la renonciation délibérée aux marques de la coordination entre les mots, les groupes de mots, les propositions ou même les phrases ainsi que la répétition, ressortissent à l’esthétique du « beau négligé ». Dans le contexte historique de la période de transition entre la Révolution et l’Empire ce style constitue une troisième voie entre le laconisme révolutionnaire et la rémanence du style périodique cicéronien abondant et diffus hérité de l’enseignement des Jésuites. On mesure ici les enjeux politiques de ce choix esthétique même si la persistance de l’héritage de la rhétorique de l’Ancien Régime dans les écrits et discours des Révolutionnaires fait apparaître souvent comment un vœu pieux le désir de ces derniers de s’affranchir des habitudes associées à l’ordre ancien2. Par ailleurs il est possible de voir dans la prédilection de Madame de Staël pour un style constituant une alternative délibérée à la symétrie de la rhétorique classique une réaction à l’esthétique néo-classique éminemment associée à la figure montante de Napoléon Bonaparte qui venait de s’autoproclamer Premier Consul à la date de la parution de De la littérature en 1800.
L’itinéraire politico-esthétique de Madame de Staël reflète la volonté d’éviter la reproduction inerte d’un modèle ancien tout en refusant l’extrémisme des Jacobins que celui-ci s’accompagne ou non d’une volonté d’adopter un style lapidaire. Après quelques illustrations de la troisième voie consistant à promouvoir l’esthétique du beau négligé de préférence au style périodique nous nous demanderons quels modèles ont bien pu influencer cette écrivaine dans son goût pour un style délibérément négligé qui semble souvent traduire formellement une charge émotive feinte ou authentique.
Bien entendu, le beau négligé staëlien n’apparaît pas à chaque page de De la littérature, œuvre qui ressortit au genre du traité didactique et qui par conséquent n’évite pas toujours le style ronronnant du conférencier. Une lecture attentive de ce traité révèle que le style asyndétique, paratactique et anaphorique apparaît de préférence lors des moments forts de l’exposé. Nous verrons enfin que le beau négligé de Madame de Staël semble avoir fait école chez Verlaine, poète qui passe souvent pour le représentant du mouvement symboliste mais qu’il vaudrait peut-être mieux considérer comme un néo-romantique. Nous proposerons une lecture de « L’Art poétique » de Verlaine comme la continuation de cette esthétique de l’hésitation et de l’indécision que Madame de Staël a pratiquée comme pour mettre en œuvre dans sa prose l’idéal esthétique ossianique qu’elle évoque de façon ecphrastique dans De la littérature.
1. Style asyndétique, paratactique et anaphorique dicté par l’indignation
Le chapitre VIII de la Seconde partie de De la littérature intitulé De l’Éloquence reprend le débat du Dialogue des orateurs de Tacite sur la pertinence de la rhétorique sous le principat en l’adaptant au contexte de la France postrévolutionnaire. Dans son plaidoyer polémique en faveur de la rhétorique (appelée ici éloquence selon les habitudes du temps) Madame de Staël semble considérer les dix ans qu’a duré la Révolution (1789-1799) comme la cause du discrédit où est tombée la rhétorique. Cette opinion est diamétralement opposée à celle de Curatius Maternus qui voyait dans le chaos propre au régime républicain la matrice qui avait rendu possible la floraison de la rhétorique. Pour la fille du meilleur ministre de l’Ancien régime finissant les effets pervers de la Révolution3 (l’évolution vers la tyrannie, le silence coupable des élites et la montée en puissance d’une classe de parvenus) sont responsables de la décadence de l’art oratoire. Pour déplorer cette situation Madame de Staël met en œuvre la tierce voie constituée par la renonciation délibérée à la coordination pour rendre plus véhémente sa protestation contre la perte du Sitz im Leben de l’éloquence dans une société réduite au silence. Voici donc un extrait où le style de l’invective recourt aux figures du beau négligé.
Dans quel espoir désirez‐vous, pourrait‐on me dire, que des hommes éloquents se fassent entendre ? L’éloquence ne peut se composer que d’idées morales et de sentiments vertueux : et dans quels cœurs retentiraient maintenant des paroles généreuses ? Après dix ans de révolution, qui s’émeut encore pour la vertu, la délicatesse, ou même la bonté ? Cicéron, Démosthène, les plus grands orateurs de l’antiquité, s’ils existaient de nos jours, pourraient‐ils agiter l’imperturbable sang‐froid du vice ? Feraient-ils baisser ces regards que la présence d’un honnête homme ne trouble plus ? Dites à ces tranquilles possesseurs des jouissances de la vie que leurs intérêts sont menacés, et vous inquiéterez leur âme impassible ; mais que leur apprendrait l’éloquence ? Elle invoquerait contre eux le mépris de la vertu : et depuis longtemps ne savent‐ils pas que chacun de leurs jours en est couvert ? Vous adresserez‐vous aux hommes avides d’acquérir de la fortune, nouveaux qu’ils sont aux habitudes comme aux jouissances qu’elle permet ? Si vous leur inspiriez un instant de nobles desseins, le courage leur manquerait pour les accomplir. N’ont‐ils pas à rougir de leur déplorable vie ? Il est sans force, l’homme à qui l’on peut reprocher des bassesses : ne craint‐il pas toutes les voix qui peuvent l’accuser ? Ne craint‐il pas la justice, la liberté, la morale, tout ce qui rend à l’opinion sa force et à la vérité son rang ? Voulez‐vous du moins faire entendre aux caractères haineux quelques paroles de bienveillance : vous serez également repoussé. Si vous parlez au nom de la puissance, ils vous écouteront avec respect, quel que soit votre langage ; mais si vous réclamez pour le faible, si votre nature généreuse vous fait préférer la cause délaissée par la faveur et recueillie par l’humanité, vous n’exciterez que le ressentiment de la faction dominante. Vous vivez dans un temps où l’on est indigné contre le malheur, irrité contre l’opprimé, où la colère s’enflamme à l’aspect du vaincu, où l’on s’attendrit, où l’on s’exalte pour le pouvoir, dès qu’on entre en partage avec lui4.
On retrouve dans cet extrait les principales caractéristiques du beau négligé :
- l’asyndète dans une énumération ternaire dont le 3e et dernier élément représente une expansion des deux termes précédents (aussi bien quant à la portée sémantique que de par le volume qu’occupe ce 3e terme) :
Cicéron, Démosthène, les plus grands orateurs de l’antiquité,
- la parataxe de deux propositions indépendantes :
Il est sans force, l’homme à qui l’on peut reprocher des bassesses : ne craint‐il pas toutes les voix qui peuvent l’accuser ?
Voulez‐vous du moins faire entendre aux caractères haineux quelques paroles de bienveillance : vous serez également repoussé
- la parataxe de deux propositions subordonnées conditionnelles de même statut sans la reprise de la seconde conjonction au moyen de que : 5
si vous réclamez pour le faible, si votre nature généreuse vous fait préférer la cause délaissée par la faveur et recueillie par l’humanité
- la parataxe de quatre relatives introduites par où :
Vous vivez dans un temps où l’on est indigné contre le malheur, irrité contre l’opprimé, où la colère s’enflamme à l’aspect du vaincu, où l’on s’attendrit, où l’on s’exalte pour le pouvoir,
- l’anaphore :
ne craint‐il pas toutes les voix qui peuvent l’accuser ? Ne craint‐il pas la justice, la liberté, la morale, tout ce qui rend à l’opinion sa force et à la vérité son rang ?
2. Le recours au beau négligé dicté par l’émotion de la confidence
Dans l’extrait suivant Madame de Staël se plaint avec un soupçon de fausse modestie des effets pervers entraînés par les succès littéraires qu’elle a remportés à un âge précoce :
Les premiers pas qu’on fait dans l’espoir d’atteindre à la réputation sont pleins de charmes, on est satisfaite de s’entendre nommer, d’obtenir un rang dans l’opinion, d’être placée sur une ligne à part ; mais si l’on y parvient, quelle solitude, quel effroi n’éprouve-t-on pas ! On veut rentrer dans l’association commune, il n’est plus temps. L’on peut aisément perdre le peu d’éclat qu’on avait acquis ; mais il n’est plus possible de retrouver l’accueil bienveillant qu’obtiendrait l’être ignoré. Qu’il importe de veiller sur la première impulsion qu’on donne au cours de sa destinée ! C’est elle qui peut sans retour éloigner du bonheur. Vainement les goûts se modifient, les inclinations changent ainsi que le caractère, il faut rester la même puisqu’on vous croit la même ; il faut tâcher d’avoir quelques succès nouveaux puisqu’on vous hait encore pour les succès passés ; il faut traîner cette chaine des souvenirs de vos premières années, des jugements qu’on a portés sur vous, de l’existence enfin telle qu’on vous la suppose, telle qu’on croit que vous la voulez. Vie malheureuse et trois fois malheureuse ! qui éloigne peut-être de vous des êtres que vous auriez aimés, qui se seraient attachés à̀ vous, si de vains bruits n’avaient épouvanté les affections qui se nourrissent du calme et du silence. Il faut néanmoins user la trame de cette vie telle qu’elle est formée, puisque l’imprudence de la jeunesse en a tissu les premiers fils, et chercher dans les liens chéris qui nous restent et dans les plaisirs de la pensée, quelques secours contre les blessures du cœur.6
L’émotion de la confidence feinte ou sincère s’y exprime par un recours intense aux divers procédés du style du beau négligé décrit ci-dessus :
- parataxe entre deux propositions indépendantes :
on veut rentrer dans l’association commune, il n’est plus temps.
Vainement les goûts se modifient, les inclinations changent ainsi que le caractère, il faut rester la même puisqu’on vous croit la même ;
- parataxe entre deux propositions subordonnées :
des êtres que vous auriez aimés, qui se seraient attachés à vous,
- asyndètes emboîtées (entre des membres de phrase) :
cette chaîne des souvenirs de vos premières années, des jugements qu’on a portés sur vous, de l’existence enfin telle qu’on vous la suppose, telle qu’on croit que vous la voulez.
- combinaison de la parataxe entre deux propositions et de l’asyndète :
Les premiers pas qu’on fait dans l’espoir d’atteindre à la réputation sont pleins de charmes, on est satisfaite de s’entendre nommer, d’obtenir un rang dans l’opinion, d’être placée sur une ligne à part ;
- épanorthose doublée d’une anaphore (répétition du pronom interrogatif quel employé dans la phrase exclamative) :
quelle solitude, quel effroi n’éprouve-t-on pas !
- anaphore :
il faut rester la même puisqu’on vous croit la même ; il faut tâcher d’avoir quelques succès nouveaux puisqu’on vous hait encore pour les succès passés ; il faut traîner cette chaîne des souvenirs de vos premières années,
3. La rhétorique staëlienne du beau négligé, imitation en français du style Sturm und Drang des Souffrances du jeune Werther ?
Un autre passage de De la littérature pourrait fournir une piste sur le modèle qui inspira à Madame de Staël le recours aux procédés du beau négligé. Il s’agit d’une appréciation enthousiaste des Souffrances du jeune Werther7. En louant cette œuvre et en la défendant contre les critiques dont elle a fait l’objet, l’auteure paraît imiter le texte qu’elle décrit. Le métalangage critique est donc contaminé par le langage de l’œuvre évoquée :
Le livre par excellence que possèdent les Allemands, et qu’ils peuvent opposer aux chefs-d’œuvre des autres langues, c’est Werther. Comme on l’appelle un roman, beaucoup de gens ne savent pas que c’est un ouvrage. Mais je n’en connais point qui renferme une peinture plus frappante et plus vraie des égarements de l’enthousiasme, une vue plus perçante dans le malheur, dans cet abîme de la nature, où toutes les vérités se découvrent à l’œil qui sait les y chercher.
Le caractère de Werther ne peut être celui du grand nombre des hommes. Il représente dans toute sa force le mal que peut faire un mauvais ordre social à un esprit énergique ; il se rencontre plus souvent en Allemagne que partout ailleurs. On a voulu blâmer l’auteur de Werther de supposer au héros de son roman une autre peine que celle de l’amour, de laisser voir dans son âme la vive douleur d’une humiliation, et le ressentiment profond contre l’orgueil des rangs, qui a causé cette humiliation ; c’est, selon moi, l’un des plus beaux traits de génie de l’ouvrage. Goethe voulait peindre un être souffrant par toutes les affections d’une âme tendre et fière ; il voulait peindre ce mélange de maux, qui seul peut conduire un homme au dernier degré du désespoir8.
Voici les manifestations du beau négligé dans l’extrait ci-dessus :
- asyndète :
On a voulu blâmer l’auteur de Werther de supposer au héros de son roman une autre peine que celle de l’amour, de laisser voir dans son âme la vive douleur d’une humiliation,
- asyndètes/épanorthoses emboîtées :
qui renferme une peinture plus frappante et plus vraie des égarements de l’enthousiasme, une vue plus perçante dans le malheur, dans cet abîme de la nature,
- épanorthose doublée d’une anaphore :
Goethe voulait peindre un être souffrant par toutes les affections d’une âme tendre et fière ; il voulait peindre ce mélange de maux,
Il est tentant de reconnaître dans ce style un essai d’adaptation au français du style du Sturm und Drang tel qu’il se manifeste notamment dans Les souffrances du jeune Werther9. Comparé avec d’autres romans épistolaires précédant la parution du roman de Goethe en 1774 (les romans de Richardson et la Nouvelle Héloïse par exemple), le Werther est beaucoup plus marqué par le recours au style fiévreux dont le beau négligé de Madame de Staël paraît être l’adaptation. Certes les lettres les plus enflammées de La Nouvelle Héloïse10 contiennent des parataxes et des anaphores qui viennent parfois briser le ronronnement de la phrase périodique, manifestation formelle de l’attachement de Rousseau à des stéréotypes éculés11. Il apparaît néanmoins que Madame de Staël a systématisé et intensifié l’expression de l’émotion non seulement dans le roman épistolaire Delphine mais aussi dans le texte théorique De la littérature.
Pour bien faire comprendre ce que Madame de Staël doit à l’esthétique du Sturm und Drang, j’ai tenu à citer l’un des moments forts du Werther, à savoir le début de la lettre d’adieu du héros à Charlotte, portant la date du 21 décembre 1772. On y voit foisonner les figures du style asyndétique et parataxique ainsi que le recours systématique à l’épanorthose et à l’anaphore12. Comme Madame de Staël ne semble avoir appris l’allemand qu’après avoir lu le Werther et plus précisément à partir de l’année même de la parution de De la littérature13, j’ai tenu à citer la troisième traduction française du roman qui fut effectuée à partir de la première édition de l’original (1774) et qui était la plus répandue à l’époque de la composition de De la littérature14.
original allemand
traduction française de Philippe François Aubry
Zum letztenmale denn, zum letztenmale schlage ich diese Augen auf, sie sollen ach die Sonne nicht mehr sehen, ein trüber, neblichter Tag hält sie bedeckt. So traure denn, Natur, dein Sohn, dein Freund, dein Geliebter naht sich seinem Ende. Lotte, das ist ein Gefühl ohne gleichen, und doch kommt es dem dämmernden Traum am nächsten, zu sich zu sagen: das ist der letzte Morgen. Der letzte! Lotte, ich habe keinen Sinn für das Wort, der letzte! Steh ich nicht da in meiner ganzen Kraft, und morgen liege ich ausgestreckt und schlaff am Boden. Sterben! Was heißt das? Sieh wir träumen, wenn wir vom Tode reden. Ich habe manchen sterben sehen, aber so eingeschränkt ist die Menschheit, daß sie für ihres Daseins Anfang und Ende keinen Sinn hat. Jetzt noch mein, dein! Dein! o Geliebte! Und einen Augenblick — getrennt, geschieden —vielleicht auf ewig? – Nein, Lotte, nein — Wie kann ich vergehen, wie kannst du vergehen? Wir sind ja! — Vergehen! — Was heißt das? das ist wieder ein Wort! ein leerer Schall ohne Gefühl für mein Herz. — Tot, Lotte! Eingescharrt der kalten Erde, so eng! so finster! — Ich hatte eine Freundin, die mein Alles war meiner hülflosen Jugend, sie starb und ich folgte ihrer Leiche, und stand an dem Grabe. Wie sie den Sarg hinunterließen und die Seile schnurrend unter ihm weg und wieder herauf schnellten, dann die erste Schaufel hinunter schollerte und die ängstliche Lade einen dumpfen Ton wiedergab, und dumpfer und immer dumpfer, und endlich bedeckt war! — Ich stürzte neben das Grab hin — Ergriffen erschüttert geängstet zerrissen mein innerstes, aber ich wußte nicht, wie mir geschah, — wie mir geschehen wird — Sterben! Grab! Ich verstehe die Worte nicht!
C’est donc pour la derniere fois, pour la
derniere fois que j’ouvre ces yeux ; ils ne
doivent plus revoir la lumiere ; un jour sombre & nébuleux les couvre. Sois donc en deuil, ô nature, ton fils, ton ami, ton bien-aimé s’approche de sa fin. Lolotte, c’est un sentiment qui n’a point de pareil, & qui pourtant approche le plus du vague, de la vapeur incertaine d’un songe, que de se dire : Ce matin est le dernier. Le dernier ! Lolotte, je n’ai aucune idée de ce mot, le dernier ! Ne suis-je pas là dans toute ma
force ? Et demain, couché, étendu, endormi sur la terre ! Mourir ! Qu’est-ce que cela signifie ? Vois-tu, nous rêvons quand nous parlons de la mort. J’ai vu mourir plusieurs personnes ; mais l’humanité est si bornée, qu’elle n’a aucun sentiment du commencement & de la fin de son existence. Actuellement encore tout à moi, à toi ! à toi ! ma chere ; & un moment de plus — séparés — désunis — peut-être
pour jamais. Non ! Lolotte, non. Comment
puis-je être anéanti ? Comment peux tu
être anéantie ? Nous sommes, oui ! —
S’anéantir ! — Qu’est ce que cela signifie ?
C’est encore un mot ! un vain son qui
ne porte aucun sentiment à mon cœur. —Mort, Lolotte ! Enseveli dans un coin de
la terre froide, si étroit, si obscur ! —
J’eus une amie qui étoit tout pour moi dans l’abondance de ma jeunesse, Elle
mourut, je suivis le convoi, & me tins
auprès de la fosse. Comme ils descendirent
le cercueil ! comme les cordes ronfloient
à mesure qu’ils les laissoient couler, & qu’ils
les retiroient ! Comme la premiere pelletée
de terre tomba par mottes sur ce coffre
funebre qui rendit un bruit sourd, puis
plus sourd, & plus sourd encore, jusqu’à
ce qu’enfin il se trouva entiérement couvert ! — Je tombai auprès de la fosse — saisi, agité, oppressé, les entrailles déchirées ; mais je ne savois ce que j’étois, — ce que je serai — Mourir ! Sépulchre ! Je n’entends point ces mots !O vergib mir! vergib mir! Gestern! Es hätte der letzte Augenblick meines Lebens sein sollen. O du Engel! Zum erstenmale, zum erstenmale ganz ohne Zweifel durch mein innig innerstes durchglühte mich das Wonnegefühl: Sie liebt mich! Sie liebt mich! Es brennt noch auf meinen Lippen das heilige Feuer, das von den deinigen strömte, neue warme Wonne ist in meinem Herzen. Vergib mir! vergib mir! O pardonne-moi ! Pardonne-moi ! Hier !
c’auroit dû être le dernier moment de ma
vie. O ange ! ce fut pour la premiere fois,
oui pour la premiere fois que ce sentiment
d’une joie sans bornes pénétra tout entier,
& sans aucun mélange de doute, dans mon
ame : elle m’aime ! elle m’aime ! Mes levres
sont encore brûlées de ce feu sacré dont
les tiennes les ont inondées ; une nouvelle
joie consume mon cœur. Pardonne-moi !
Pardonne-moi !Ach, ich wußte, daß du mich liebtest, wußte es an den ersten seelenvollen Blicken, an dem ersten Händedruck, und doch wenn ich wieder weg war, wenn ich Alberten an deiner Seite sah, verzagte ich wieder in fieberhaften Zweifeln. Ah ! je le savois, que j’étois aimé ! Tes
premiers regards, ces regards pleins d’ame,
ton premier serrement de main, me l’apprirent ; & cependant lorsque je te quittois, ou que je voyois Albert à tes côtés, je retombois dans mes doutes rongeurs.Erinnerst du dich der Blumen die du mir schicktest, als du in jener fatalen Gesellschaft mir kein Wort sagen, keine Hand reichen konntest, o ich habe die halbe Nacht davor gekniet, und sie versiegelten mir deine Liebe. Aber ach! diese Eindrücke gingen vorüber, wie das Gefühl der Gnade seines Gottes allmählich wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer Himmelsfülle in heiligen, sichtbaren Zeichen gereicht ward. Te souvient-il de ces fleurs que tu me donnas dans cette fatale assemblée où tu ne pus ni me dire un seul mot, ni me présenter la main ? Hélas ! je restai la moitié de la nuit à genoux devant ces fleurs, & elles furent pour moi le sceau de ton amour, Mais hélas ! ces impressions le sont effacées comme on voit insensiblement s’effacer dans le cœur du Chrétien le sentiment de la grace a de son Dieu, que le Ciel lui offrit avec profusion sous des signes sacrés & manifestes. Alles das ist vergänglich, keine Ewigkeit soll das glühende Leben auslöschen, das ich gestern auf deinen Lippen genoß, das ich in mir fühle! Sie liebt mich! Dieser Arm hat sie umfaßt, diese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund hat an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein! du bist mein! ja Lotte auf ewig. Tout cela est périssable ; mais l’éternité
même ne pourra point détruire la vie brûlante dont je jouis hier sur tes levres, & que je sens en moi. Elle m’aime ! ce bras l’a pressée ! Ces levres ont tremblé sur ses levres ! Cette bouche a balbutié sur la sienne ! Elle est à moi ! Tu es à moi ! Oui, Lolotte, pour jamais !Und was ist das? daß Albert dein Mann ist! Mann? — Das wäre denn für diese Welt — und für diese Welt Sünde, daß ich dich liebe, daß ich dich aus seinen Armen in die meinigen reißen möchte? Sünde? Gut! und ich strafe mich davor: ich habe sie in ihrer ganzen Himmelswonne geschmeckt diese Sünde, habe Lebensbalsam und Kraft in mein Herz gesaugt, du bist von diesem Augenblicke mein! Mein, o Lotte. Ich gehe voran! Gehe zu meinem Vater, zu deinem Vater, dem will ich's klagen, und er wird mich trösten bis du kommst, und ich fliege dir entgegen und fasse dich und bleibe bei dir vor dem Angesichte des Unendlichen in ewigen Umarmungen. Qu’importe qu’Albert soit ton mari ? Ma-
ri ! — Ce titre seroit seulement pour ce
monde. — Et pour ce monde le péché que
je commets en t’aimant, en désirant de
t’arracher, si je pouvois, de ses bras dans
les miens ? Péché ? Soit ! Et bien, je m’en
punis : je l’ai savouré ce péché dans le transport de la plus douce volupté ; j’ai sucé le baume de la vie, & versé la force dans mon cœur ; de ce moment tu es à moi, à moi, ô Lolotte ! Je pars devant. Je vais rejoindre mon pere, ton pere ; je me plaindrai devant lui ; il me consolera jusqu’à
ton arrivée ; alors je vole à ta rencontre ;
je te saisis, & demeure uni à toi en présence de l’Eternel, dans des embrassemens qui ne finiront jamais.Ich träume nicht, ich wähne nicht! nah am Grabe wird mir es heller. Wir werden sein, wir werden uns wieder sehen! Deine Mutter sehen! ich werde sie sehen, werde sie finden, ach und vor ihr mein ganzes Herz ausschütten! Deine Mutter, dein Ebenbild.
Je ne rêve point, je ne suis point dans le délire ! L’approche du tombeau fut pour moi une nouvelle lumiere. Nous serons, nous nous reverrons ! Nous verrons ta mere ! je la verrai, je la trouverai, hélas ! & je lui exposerai tout mon cœur. Ta mere. Ta parfaite image.
Voici un relevé des figures du style fiévreux et passionné du Sturm und Drang15 dont la citation ci-dessus constitue un échantillon typique :
- anaphores doublées d’asyndètes :
Zum letztenmale denn, zum letztenmale
« pour la derniere fois, pour la derniere fois »
das ist der letzte Morgen. Der letzte! Lotte, ich habe keinen Sinn für das Wort, der letzte!
« Ce matin est le dernier. Le dernier ! Lolotte, je n’ai aucune idée de ce mot, le dernier ! »
vergib mir ! vergib mir ! (à deux reprises dans le même paragraphe)
« Pardonne-moi ! Pardonne-moi ! »
Zum erstenmale, zum erstenmale
« ce fut pour la premiere fois, oui pour la premiere fois »
Sie liebt mich ! Sie liebt mich !
« elle m’aime ! elle m’aime ! »
ich wußte, daß du mich liebtest, wußte es an den ersten seelenvollen Blicken, an dem ersten Händedruck
« Tes premiers regards, ces regards pleins d’ame, ton premier serrement de main, me l’apprirent »16
als du in jener fatalen Gesellschaft mir kein Wort sagen, keine Hand reichen konntest
« dans cette fatale assemblée où tu ne pus ni me dire un seul mot, ni me présenter la main ? »
Und was ist das? daß Albert dein Mann ist! Mann? — Das wäre denn für diese Welt — und für diese Welt Sünde, daß ich dich liebe, daß ich dich aus seinen Armen in die meinigen reißen möchte? Sünde?
« Qu’importe qu’Albert soit ton mari ? Mari ! — Ce titre seroit seulement pour ce monde. — Et pour ce monde le péché que je commets en t’aimant, en désirant de t’arracher, si je pouvois, de ses bras dans les miens ? Péché ? »
du bist von diesem Augenblicke mein! Mein, o Lotte
« de ce moment tu es à moi, à moi »
- épanorthoses :
Jetzt noch mein, dein! Dein !
« Actuellement encore tout à moi, à toi ! à toi ! »
Sie ist mein ! du bist mein !
« Elle est à moi ! Tu es à moi ! »
Deine Mutter, dein Ebenbild.
« Ta mere. Ta parfaite image. »
- épanorthoses doublées d’anaphores :
Nein, Lotte, nein — Wie kann ich vergehen, wie kannst du vergehen? Wir sind ja! — Vergehen!
« Non ! Lolotte, non. Comment puis-je être anéanti ? Comment peux tu être anéantie ? Nous sommes, oui ! — S’anéantir ! »
ich wußte nicht, wie mir geschah, — wie mir geschehen wird
« je ne savois ce que j’étois,— ce que je serai »
Gehe zu meinem Vater, zu deinem Vater,
« Je vais rejoindre mon pere, ton pere »
Wir werden sein, wir werden uns wieder sehen! Deine Mutter sehen! ich werde sie sehen, werde sie finden,
« Nous serons, nous nous reverrons ! Nous verrons ta mere ! je la verrai, je la trouverai, »
- asyndète :
Ergriffen erschüttert geängstet zerrissen mein innerstes
« saisi, agité, oppressé, les entrailles déchirées »
4. Le beau négligé de Madame de Staël, mise en œuvre de l’idéal esthétique de la grisaille mélancolique et du brouillage des limites ?
Dans un autre passage de La littérature c’est l’éloge de la poésie mélancolique d’Ossian17 qui semble avoir dicté le recours au beau négligé :
La poésie mélancolique est la poésie la plus d’accord avec la philosophie. La tristesse fait pénétrer bien plus avant dans le caractère et la destinée de l’homme, que toute autre disposition de l’âme. Les poètes anglais qui ont succédé́ aux Bardes Ecossais, ont ajouté́ à leurs tableaux les réflexions et les idées que ces tableaux même devaient faire naître ; mais ils ont conservé l’imagination du nord, celle qui se plaît sur le bord de la mer, au bruit des vents, dans les bruyères sauvages ; celle enfin qui porte vers l’avenir, vers un autre monde, l’âme fatiguée de sa destinée. L’imagination des hommes du nord s’élance au-delà̀ de cette terre dont ils habitaient les confins ; elle s’élance à travers les nuages qui bordent leur horizon, et semblent représenter l’obscur passage de la vie à l’éternité18.
Cette description métapoétique de la quintessence de la poésie des « hommes du nord » recourt à trois des quatre figures qui constituent à notre sens les ingrédients du beau négligé de Madame de Staël :
- asyndète :
celle qui se plaît sur le bord de la mer, au bruit des vents, dans les bruyères sauvages ; celle enfin qui porte vers l’avenir,
L’asyndète ci-dessus met en parallèle celle et celle enfin qui. Dans cette juxtaposition des deux propositions relatives apposées à l’antécédent l’imagination du nord grâce au pronom démonstratif employé comme antécédent, l’adverbe enfin ne fonctionne pas comme un coordonnant mais comme un marqueur pragmatique à visée résomptive.
- épanorthose :
vers l’avenir, vers un autre monde,
- anaphore :
L’imagination des hommes du nord s’élance au‐delà de cette terre dont ils habitaient les confins ; elle s’élance à travers les nuages qui bordent leur horizon,
Comme dans la défense du Werther étudiée ci-dessus, l’usage des figures de l’indécision et de l’hésitation dans l’évocation de la poésie du nord, dont Ossian est le parangon, illustre la perméabilité des frontières entre le texte littéraire et le discours critique sur ce dernier. En l’occurrence la chaîne des influences est plus complexe encore : de l’original anglais des poèmes ossianiques aux traductions allemandes de ces derniers ; des traductions allemandes de Macpherson au texte du Werther ; de l’original du Werther à sa traduction en français (celle d’Aubry certainement) ; de la traduction d’Aubry au discours critique sur la littérature ; de De la littérature à l’écriture romanesque de Madame de Staël.
5. Verlaine staëlien ? L’extension du beau négligé à la poésie entre théorie et mise en pratique
L’esthétique du beau négligé dont nous avons cherché à retrouver les racines dans les textes du préromantisme anglais (Macpherson) et allemand (Sturm und Drang) a été acclimatée à l’horizon littéraire français par Madame de Staël. Cette troisième voie entre la perpétuation de la rhétorique cicéronienne et le refus de cette dernière n’a pas forcément été cultivée par les représentants du Romantisme français. Pour la retrouver il faut chercher du côté de la prose romantique de la première moitié du XIXe siècle19 : le Musset de La Confession d’un enfant du siècle et par endroit, l’œuvre de George Sand ; Michelet plutôt que le Hugo de Notre-Dame de Paris qui oscille entre le style diffus hérité de la rhétorique et le goût pour les formules lapidaires et même pour les phrases nominales. Pour trouver une résurgence du beau négligé inauguré par Madame de Staël il faut aller jusqu’à Verlaine que les historiens de la littérature rangent le plus souvent dans la niche du symbolisme plutôt que dans celle du romantisme. Pourtant, sans parler de certains liens rattachant Verlaine au romantisme20, l’esthétique verlainienne de l’hésitation et de l’indécision telle qu’elle est formulée dans « Art poétique » correspond assez bien à l’idéal de la poésie ossianique formulé par Madame de Staël21. Du reste la première version d’« Art poétique », écrite en prison en avril 1874, était précédée d’une épigraphe tirée du texte original de La Nuit des rois de Shakespeare, ce parfait représentant des littératures du Nord auquel est consacré un chapitre entier (Ire partie, XIII) de De la littérature. Voici donc le texte d’« Art poétique » dans lequel j’ai souligné les expressions qui pourraient faire référence à l’idéal poétique ossianique tel qu’il est décrit et pratiqué par Madame de Staël :
Art poétique
De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l’Impair
Plus vague et plus soluble dans l’air,
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.Il faut aussi que tu n’ailles point
Choisir tes mots sans quelque méprise :
Rien de plus cher que la chanson grise
Où l’Indécis au Précis se joint.C’est des beaux yeux derrière des voiles,
C’est le grand jour tremblant de midi,
C’est, par un ciel d’automne attiédi,
Le bleu fouillis des claires étoiles !Car nous voulons la Nuance encor,
Pas la Couleur, rien que la nuance !
Oh ! la nuance seule fiance
Le rêve au rêve et la flûte au cor !Fuis du plus loin la Pointe assassine,
L’Esprit cruel et le Rire impur,
Qui font pleurer les yeux de l’Azur,
Et tout cet ail de basse cuisine !Prends l’éloquence et tords-lui son cou !
Tu feras bien, en train d’énergie,
De rendre un peu la Rime assagie.
Si l’on n’y veille, elle ira jusqu’où ?Ô qui dira les torts de la Rime ?
Quel enfant sourd ou quel nègre fou
Nous a forgé ce bijou d’un sou
Qui sonne creux et faux sous la lime ?De la musique encore et toujours !
Que ton vers soit la chose envolée
Qu’on sent qui fuit d’une âme en allée
Vers d’autres cieux à d’autres amours.Que ton vers soit la bonne aventure
Éparse au vent crispé du matin
Qui va fleurant la menthe et le thym…
Et tout le reste est littérature22.
Les vers soulignés appellent quelques remarques destinées à montrer en quoi ce texte programmatique et prescriptif23 peut être considéré comme la reprise plus ou moins consciente de l’idéal esthétique des littératures du nord incarné par Ossian et décrit par Madame de Staël :
v. 1 et 29 :
De la musique avant toute chose,
(...)
De la musique encore et toujours !
La conception de la poésie comme plus musicale que visuelle pourrait faire écho à l’opposition staëlienne entre Homère, poète plastique de l’extériorité, et Ossian, poète musical de l’intériorité.
v. 7-8 :
Rien de plus cher que la chanson grise
Où l’Indécis au Précis se joint.
La « chanson grise » n’est pas seulement le résultat du brouillage des couleurs dans la perspective d’une poésie plus auditive et intérieure que visuelle et extérieure. Cette grisaille pourrait également faire penser à l’association à laquelle Madame de Staël procède souvent entre Ossian et les paysages brumeux de l’Écosse (comme dans l’extrait du chapitre XIV cité ci-dessus).
v. 14 : Pas la Couleur, rien que la nuance !
Reprise du thème du brouillage, voire de l’abolition des couleurs déjà évoqué à travers l’expression « chanson grise ».
L’hypothèse qui reconnaît dans « Art poétique » certains traits de l’esthétique ossianique telle que la concevait Madame de Staël est corroborée par le fait qu’au VIe et dernier chapitre de l’édition augmentée de son essai Les poètes maudits24 Verlaine se présente sous le pseudonyme anagrammatique de Pauvre Lelian. Sachant qu’une fois extrait le nom éminemment signifiant de Pauvre, d’autres combinaisons de lettres que Lelian étaient envisageables, il faut sans doute conférer du sens au choix de cet hétéronyme qui fait penser au nom irlandais épicène Lilián et qui se trouve rimer avec Ossian25.
Conclusion
Les passages de De la littérature analysés ci-dessus constituent des points forts de cette œuvre. Ils se détachent nettement du reste de l’exposé rédigé le plus souvent dans le style ronronnant d’un discours professoral. Cette irruption d’une tonalité passionnée est dictée par des sentiments profonds (indignation ; confidence) ou par une adéquation mimétique aux textes décrits (le Werther ; la poésie ossianique). Elle annonce l’écriture romanesque de Madame de Staël telle qu’elle se manifeste dans toute son ampleur dans Delphine et Corinne ainsi que dans d’autres romans moins connus de cette femme de lettres.
De la confrontation du style du beau négligé tel qu’il se déploie dans toute sa splendeur dans les propos de De la littérature sur Werther et sur Ossian il ressort que cette tierce voie entre la rhétorique jésuitique et le laconisme lapidaire des Révolutionnaires n’est pas tant une une innovation que la continuation en français de l’écriture du Sturm und Drang (connue de Madame de Staël à travers une traduction française) ou de la poésie pseudo-celtique de Macpherson que l’auteure, comme tous ses contemporains, considérait en toute bonne foi comme une traduction du gaélique d’Écosse. Il est donc tentant de considérer l’écriture de Madame de Staël comme un aboutissement plutôt qu’un commencement. La visée subsumante et récapitulatrice de De la littérature pourrait corroborer une telle appréciation du statut de cette femme plus ancrée dans le XVIIIe siècle que dans le siècle nouveau. Elle représenterait donc le point d’arrivée du préromantisme européen plutôt que le début du premier romantisme français. Celui-ci constituerait-il l’inauguration d’un courant nouveau ? La lecture de Chateaubriand peut apporter une réponse nuancée à cette question : l’auteur du Génie du christianisme, publié deux ans après De la littérature, ne doit sans doute rien au Sturm und Drang allemand. De plus, son rejet d’Homère ne se fait pas au profit d’Ossian, comme Dans la littérature, mais en faveur de la poétique biblique et chrétienne désignée métonymiquement par le cinnor de David26. Paradoxalement, la celtomanie de Chateaubriand est moins apparente que celle de Madame de Staël. À la différence de cette dernière, le gentilhomme breton n’était pas dupe de la supercherie de Macpherson27. Outre que ce romantique était ethniquement celte, il n’a guère souscrit à la thématique celtomaniaque qu’à travers l’insertion anachronique de la prophétesse gauloise Velléda dans la narration des Martyrs28. Quoi qu’il en soit, le style de Chateaubriand représente davantage une continuation de la rhétorique de l’Ancien régime que l’adoption du style fiévreux et haletant du beau négligé29. La tierce voie pratiquée par Madame de Staël constituerait donc un modèle qui n’a pas forcément été repris par les Romantiques français.
Notes
1 Sur l’asyndète et la parataxe avant Madame de Staël, voir Geneviève Salvan, « Parataxe, asyndète et “stile coupé” au XVIIIe siècle », in : Marie-José Béguelin, Mathieu Avanzi et Gilles Corminbœuf (dir.), La parataxe (tome I : entre dépendance et intégration), Berne, Peter Lang, 2010, p. 55-68.
2 Agnès Steuckardt, « Style laconique et style abondant dans la rhétorique révolutionnaire », L’Information grammaticale, 113 (mars 2007) : 7-11.
3 Sur la critique des excès de la Révolution française telle qu’elle s’exprime dans les essais politiques de Madame de Staël, notamment dans Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution et des principes qui doivent fonder la république en France, écrit deux ans avant la parution de De la littérature et publié seulement en 1905, voir Gretchen R. Besser, Germaine de Staël Revisited, New York, Twayne, 1994, p. 36-46.
4 Madame de Staël, De la littérature, Ire partie, Chapitre VIII (« De l’Éloquence »), éd. Gérard Gengembre et Jean Goldzink, Paris, Garnier Flammarion, 2024, p. 399-400.
5 Sur la différence de sens entre si… et que et si…(et) si, voir Léon Clédat et Pierre Horluc, « La répétition de “si” dans les propositions conditionnelles coordonnées », Revue de philologie française et de littérature, tome XVII, fascicule 1 (1903), p. 1-18.
6 Madame de Staël, De la littérature, IIe partie, Chapitre IX et dernier, (« Conclusion »), p. 415.
7 Sur l’importance que cette œuvre revêt pour Mme de Staël, voir Robert de Luppé, « Mme de Staël et Werther », in Madame de Staël et l’Europe : colloque de Coppet (18-24 juillet 1966) organisé pour la Célébration du Deuxième Centenaire de la Naissance de Madame de Staël (1766-1966), Paris, Klincksieck, 1970, p. 111-118.
8 Madame de Staël, De la littérature, Ire partie, Chapitre XVII (« De la Littérature allemande »), p. 258-259.
9 Sur les rapports entre le Sturm und Drang et la France, voir Roland Krebs, « L’idée d’énergie dans l’esthétique du Sturm und Drang », Recherches germaniques, 26 (1996), p. 3-18, spécialement 16-18.
10 Sur les variations d’intensité émotive qui se manifestent dans les lettres de La Nouvelle Héloïse, voir Patrick Brady, « Structural Affiliation of ‘La Nouvelle Héloïse’ », L’Esprit créateur, Volume 9, Number 3 (Fall 1969), p. 207-218.
11 Jacques Berchtold, « Émotions sincères, ou lieux communs rhétoriques ? : L’expression de la passion dans la lettre I, 26 de La Nouvelle Héloïse », L’Esprit créateur, Volume 52, Number 4 (Winter 2012), p. 31-41.
12 On a pu voir dans la figure de Werther la victime de sa propre rhétorique. Voir Olaf Kramer, Goethe und die Rhetorik, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 2010, p. 196-201.
13 Maria Fairweather, Madame de Staël, Londres, Constable, 2005, p. 264.
14 Sur les premières traductions françaises des Souffrances du jeune Werther, voir Christian Helmreich, « La traduction des “Souffrances du jeune Werther” en France (1776-1850) Contribution à une histoire des transferts franco-allemands », Revue germanique internationale (Goethe cosmopolite), 12 (1999), p. 179-193.
15 Sur l’impact que le style « extrême » du Werther exerça dès sa parution, voir Heinz Schlaffer, Die kurze Geschichte der deutschen Literatur, Munich-Vienne, Carl Hanser Verlag, 2002, p. 59-62.
16 La transposition de an den ersten seelenvollen Blicken (littéralement : « aux premiers regards pleins d’âme ») par « tes premiers regards, ces regards pleins d’ame ») fait apparaître une épanorthose anaphorique de plus que l’original. Cette technique a été désignée sous le terme de compensation horizontale par Michaël Mariaule, « Le double en théorie à l’épreuve de l’entre-deux » in Michaël Mariaule et Corinne Wecksteen, dir., Le double en traduction ou l’impossible (?) entre-deux, vol. 2, Arras, Artois Presses Université, 2012, p. 15-31, spécialement 18-19.
17 La poésie d’Ossian ou du moins la supercherie littéraire de James Macpherson sont éminemment liées au Werther. En effet c’est après que Werther eut lu à Charlotte un extrait de sa propre traduction des Chants de Selma qu’éclata la scène des larmes et du baiser volé, cause directe du retrait de Charlotte et du suicide de Werther (p. 283-291 de l’édition de Sauder mentionnée à la note 14). Sur cette traduction due à Goethe mais différente de la version des Chants de Selma que le poète avait achevée un peu avant d’écrire le Werther, voir John Hennig, « Goethe’s Translation of Ossian’s ‘Songs of Selma’ », The Journal of English and Germanic Philology, Vol. 45, No. 1 (Jan., 1946), p. 77-87.
18 Madame de Staël, De la littérature, Ire partie, Chapitre XIV (« De la Littérature du Nord »), p. 205. Ce passage pourrait être inspiré d’une lettre de Werther (12 octobre 1772, p. 264 de l’édition Sauder) où le jeune homme fait l’éloge d’Ossian en des termes très similaires à ceux qu’emploie Madame de Staël.
19 Pour une description stylistique de la prose romantique à travers ses principaux représentants (Chateaubriand ; Lamennais ; Michelet ; Hugo ; Sainte-Beuve ; Théophile Gautier ; Barbey d’Aurevilly) voir Ferdinand Brunot et Charles Bruneau, Histoire de la langue française des origines à nos jours, Paris, Armand Colin, 1948-1953, XII, p. 295-365 ; XIII, 1, p. 79-162.
20 Sur la conception toute romantique que Verlaine avait de l’œuvre comme produit d’un génie créateur, voir Marie Blaise et Sylvie Triaire, « Verlaine — Les Poètes Maudits ou la valeur paradoxale”, in : Marie-Paule Berranger (dir.), Évolutions/Révolutions des valeurs critiques (1860-1940) : Mutations des idées de littérature-2, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2023, p. 67-82.
21 Sur la position pivot qu’occupe « Art poétique » dans le recueil Cellulairement entre une esthétique symboliste et dépouillée et une verve néoromantique, voir Gilles Negrello, « De la verve poétique : le Verlaine seconde manière de Cellulairement », Recherches et travaux, 85 (La verve) (2014), p. 31-46.
22 Paul Verlaine, « Art poétique », Jadis et naguère = Œuvres poétiques complètes de Verlaine, éd. Yves-Gérard Le Dantec, révisée par Jacques Borel, Paris, Gallimard, 1962, p. 326-327.
23 Le caractère prescriptif de ce texte a été mis en doute par Michel Grimaud qui y voit un texte parodique et contradictoire. Voir Michel Grimaud, « “Art poétique” de Verlaine ou la rhétorique du double-jeu », Romance Notes, Vol. 20, No. 2 (Winter 1979-80), p. 195-201. Nous choisissons néanmoins de prendre au sérieux ce texte qui semble réactualiser sur le mode néo-romantique ce que Madame de Staël avait pressentie comme étant l’essence de la poésie des peuples du nord.
24 Paul Verlaine, Les poètes maudits, édition augmentée, Paris, Léon Vanier, 1888, p. 93-102.
25 Sur cette anagramme, voir Pierre Canivenc, « Paul Verlaine et Pauvre Lelian », Littératures, 6 (1982), p. 59-64.
26 Chateaubriand, Le Génie du christianisme, IIe partie, livre V (« La Bible et Homère ») ; Les Martyrs, Livre II, 24.
27 Chateaubriand exprime ouvertement ses doutes dans une remarque sur le livre X des Martyrs. Voir François-René de Chateaubriand, Œuvres romanesques et voyages, tome 2, éd. Maurice Regard, Paris, Gallimard, 1969, p. 601.
28 Les Martyrs, livre X.
29 Sur le style éclectique de Chateaubriand, notamment dans les Mémoires d’outre-tombe, voir Jean Mourot, Le génie d’un style : Chateaubriand. Rythme et sonorité dans les Mémoires d’outre-tombe, édition revue et corrigée, Paris, Armand Colin, 1969.
Table des matières
Le bestiaire d’amour de Richard de Fournival, un chant d’amour ironique?
Les personnages féminins dans les trois comédies de Corneille
« Rien de plus cher que la chanson grise... » : indécision et hésitation dans la syntaxe de De la littérature de Madame de Staël
Quand Rushdie rend hommage à García Márquez, ou le réalisme magique comme outil de distinction
Résistance culturelle dans les poésies américaines de Joy Harjo, Miguel Asturias et Gaston Miron